Le président.
« Madame l'expert, on vous remercie. Si le professeur veut bien se lever…
On va demander à la partie civile si vous avez des questions à poser à la fois à l'expert et aux témoins qui sont là. »
L'avocat de la partie civile.
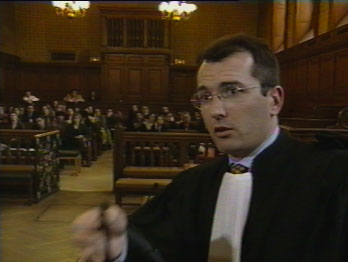 « Monsieur le président, je voudrais demander à madame si
elle pense que l'État, non seulement l'État français mais aussi les États étrangers, s'appliqueront à eux-mêmes une législation qui doit être édictée contre ces abus de nature commerciale. J'entends le mot fichier … fichier d'État --
notamment de sécurité ! … »
« Monsieur le président, je voudrais demander à madame si
elle pense que l'État, non seulement l'État français mais aussi les États étrangers, s'appliqueront à eux-mêmes une législation qui doit être édictée contre ces abus de nature commerciale. J'entends le mot fichier … fichier d'État --
notamment de sécurité ! … »
Marie Georges.
« Je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris puisque vous avez fait une relation entre les fichiers d'État -- peut-être de la sécurité publique -- et le commerce… Qu'est-ce que vous voulez dire ? Une exploitation commerciale ? »
L'avocat de la partie civile.
« Est-ce que l'État va s'appliquer à lui-même cette réglementation -- qui normalement a vocation à s'appliquer aux sociétés commerciales -- pour ses fichiers de la Sécurité Sociale, du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur ? »
Marie Georges.
« La loi française s'applique à l'ensemble des traitements. C'est une législation générale. La directive européenne bien sûr, ne s'applique qu'aux secteurs couverts par le droit communautaire, donc pas au secteur, par exemple, de la sécurité publique. Néanmoins je ne vois pas pourquoi dans la transposition, tout d'un coup, l'État français sortirait de la protection des secteurs qui étaient réglementés autrefois et qui devaient appliquer les principes. »
Le président.
« D'autres questions pour la partie civile ? »
 L'autre avocat de la partie civile.
L'autre avocat de la partie civile.
« Vous disiez, monsieur, qu'il n'y aura plus de voyou non identifié. Comme la notion de voyou et de voyoucratie est assez contingente et qu'elle dépend naturellement de l'état du corps social et de ce qu'il pense, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi la possibilité qu'il n'y ait plus de délit d'opinion non identifié ? »
Louis Pouzin.
 « Le terme voyou, dans mon esprit, s'appliquait
essentiellement au mode d'usage du réseau et non pas aux opinions que l'on peut émettre au moyen du réseau. Donc je verrais difficilement dans la pratique, sauf en cas de monopole mondial, la possibilité d'émettre des jugements --
et éventuellement des sanctions -- à l'encontre des émetteurs d'opinions. »
« Le terme voyou, dans mon esprit, s'appliquait
essentiellement au mode d'usage du réseau et non pas aux opinions que l'on peut émettre au moyen du réseau. Donc je verrais difficilement dans la pratique, sauf en cas de monopole mondial, la possibilité d'émettre des jugements --
et éventuellement des sanctions -- à l'encontre des émetteurs d'opinions. »
L'avocat de la partie civile.
« Mais est-ce qu'on pourra toujours les retrouver ? »
Louis Pouzin.
« On pourra toujours retrouver les utilisateurs. Il est clair aussi que toute personne peut utiliser un homme de paille pour introduire l'information. Les moyens de fraude que l'on connaît depuis toujours continueront d'exister. »
Le président.
« Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions ? Pas de questions à poser ? Est-ce que la défense a des questions à poser aux témoins ? »
L'avocat de la défense.
« J'ai une simple question pour ma gouverne. La CNIL a des fichiers, opère des traitements. Vous opérez auprès de vous-même une propre déclaration ? Comment est-ce que vous fonctionnez sur cette question ? »
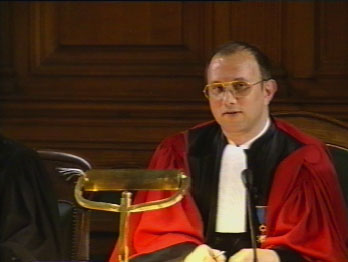 Le président.
Le président.
« Est-ce que la CNIL déclare ses fichiers à elle-même ? »
Marie Georges.
« Oui, tout à fait ! Nous appliquons les principes. Il y a des délibérations de la Commission -- c'est-à-dire l'organe délibérant -- sur les traitements qui sont mis en œuvre dans ses services. »
L'avocat de la défense.
« Et il vous arrive de vous opposer à vous-même ? »
Marie Georges.
« Il n'y a pas eu de projet contraire. La base qui envisage les projets s'informe, en général, sur la façon dont on doit s'appliquer à nous-mêmes. Il y a une concertation entre les juristes et les informaticiens. »
Le président.
« Il y a toujours une difficulté à être juge et partie quand même ! »
Marie Georges.
« La délibération est publique ! »
L'avocat de la partie civile.
« J'ai une question également pour ma gouverne personnelle. Vous avez parlé tout à l'heure, madame, du fait que les gens méconnaissaient leurs droits. Vous avez commencé par cela. Qu'est-ce qui peut être fait pour que l'accès au droit -- l'accès à la protection -- soit renforcé avec cette accélération que nous connaissons ? »
Marie Georges.
« Nous sommes dans le cadre du procès de l'Internet. Je dirais que déjà la Commission Informatique et Libertés a mit sur le Net les informations de base juridiques et que nous nous sommes efforcés, dans les années précédentes surtout, de diffuser l'information, par exemple en direction de l'Éducation Nationale, et nous avons des tas de dossiers par secteurs. Souvent les questions sont sectorielles, il est donc important de connaître l'application par secteurs. Le site Internet a été le moyen de diffusion.
Je suis effectivement très frappée, comme je l'ai dit, par le fait que chaque vague de nouvelle technologie implique de nouveaux acteurs et qu'à chaque fois la pédagogie doit être refaite.
Nous sommes à la disposition des gens, nous participons à des tas de séminaires, dans le cadre des formalités qu'il y a lieu de faire… Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Vu nos moyens, je ne vois pas pour l'instant, mais si vous avez des suggestions, si la cour a des idées… »
Le président.
« Je crois qu'il y a des questions de jurés ? »
 Un juré.
Un juré.
« J'aurais aimé savoir s'il existe un lien de dépendance ou de non-dépendance entre la CNIL et les fichiers constitués par l'État, notamment les fichiers des services centraux de renseignement. »
Marie Georges.
« Pour ce qui est des fichiers des Renseignements Généraux, ces fichiers existaient avant l'entrée en vigueur de la loi en 1978. La loi a obligé à ce qu'il y ait une réglementation de ces fichiers. C'est bien, puisque avant, ils étaient inconnus.
Il a fallu très longtemps pour entamer un dialogue -- qui a été assez publique, les rapports annuels de la CNIL en faisaient état -- pour obtenir une bonne réglementation.
Nous en avons une depuis déjà quelques années. Je dirais donc que c'est sous contrôle, il y a une réglementation publique, elle est accessible. »
Le président.
« D'autres questions ? Oui… je vous en prie ! »
Un juré, Arnaud Brunet.
« Pensez-vous qu'un seul État, se comportant en tant que pavillon de complaisance, suffise à condamner toute velléité réglementaire ? »
Marie Georges.
« Non. Jusqu'à présent, la protection des données n'avait pas a été un argument de délocalisation. Il y a eu des études, à l'OCDE, il y a quelques années, par exemple, qui le montraient. Est-ce que ce serait le cas aujourd'hui ? Je pense que cette question agite beaucoup les États entre eux. Il est très rare qu'un site d'information n'ait pas des liens avec des opérateurs qui peuvent être situés aussi dans différents lieux. Il pourrait y avoir des moyens de pression.
Néanmoins, il est exact que la reconnaissance mondiale des principes n'est pas encore suffisante pour assurer, de notre point de vue, des moyens efficaces à court terme. À moyen terme, il faudrait qu'au moins les grands partenaires commerciaux s'accordent sur des principes contraignants. Ensuite, ce serait vraisemblablement plus facile de gérer les situations plus locales.
Je voulais dire, monsieur le président, que, par rapport à la question précédente, j'ai peut-être omis de dire quelque chose d'important. On a dit : État -- la CNIL c'est aussi l'État -- donc contrôle de l'État ! Ce qui est important dans les législations européennes, c'est qu'elles ont institué -- ce qui n'était pas prévu dans la Convention 108 par exemple, mais qui est rendu obligatoire par la directive -- des autorités indépendantes de l'exécutif !
Et ceci nous semble de plus en plus important, par rapport au contrôle des fichiers d'État, mais aussi par rapport au développement de ce qui se passe dans le secteur privé. C'est peut-être aussi très important parce que cela met cet acteur dans une position médiane qui permet d'élaborer des conciliations entre des intérêts qui parfois apparaissent contradictoires, mais qui, en pratique, peuvent trouver des solutions concrètes. »
Le président.
« La Cour remercie l'expert et le témoin. Il n'y a pas d'autre témoin à entendre ?
Je vous propose maintenant que l'audience soit suspendue. Nous reprendrons ensuite les débats pour entendre la plaidoirie de la partie civile, le réquisitoire de monsieur l'avocat général et la plaidoirie de la défense.
L'audience est suspendue, elle reprendra à 15 h 45. »
© 1998-2001 denoue.org